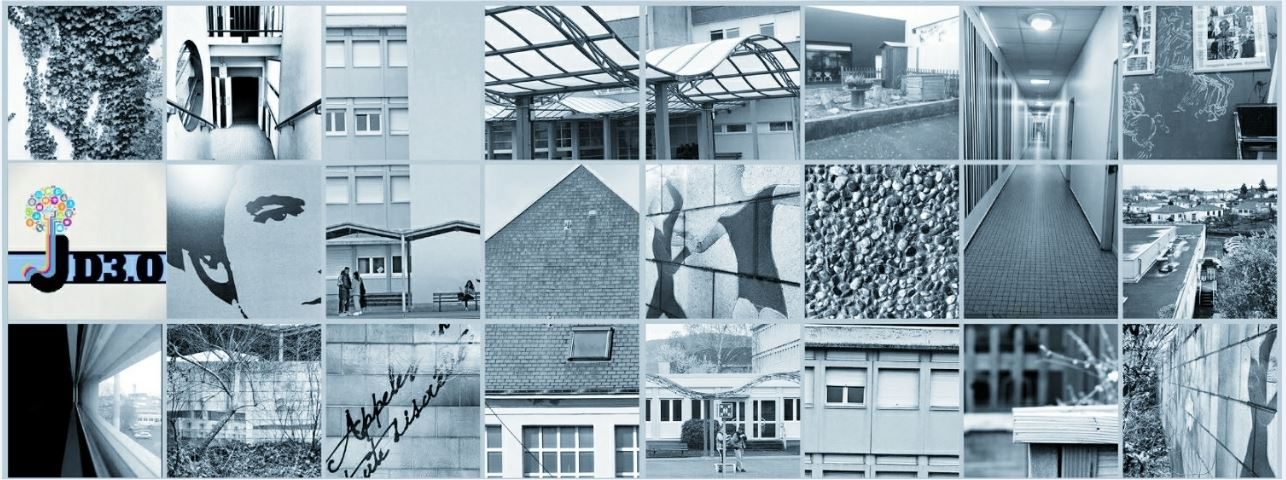Les inégalités de prise en charge des femmes dans le domaine de la santé.
Depuis toujours, en médecine, les inégalités de genre entraînent des conséquences bien réelles sur la santé des femmes. Plusieurs études montrent que les femmes sont prises en charge avec moins de réactivité que les hommes, notamment pour les maladies cardiovasculaires ou la gestion de la douleur. Cette moindre considération médicale contribue à une surmortalité féminine évitable.
Tout d’abord, la douleur portée par un individu est subjective et seul celui ou celle qui la ressent est le/la mieux placé(e). Pourtant les médecins ont tendance à faire plus confiance aux hommes qu’aux femmes. Ainsi la douleur des hommes est perçue plus grave. Par ailleurs, une expérience a été faite en juin 2024 dans European Journal of emergency Médecine par des chercheurs à l’université de Montpellier. Ils ont réuni 1563 médecins/infirmiers qui devaient évaluer la gravité des douleurs à la poitrine des patients. Ils possédaient en plus les histoires médicales de ces derniers, la seule différence était le genre soit femmes ou hommes. Or, 62% des soignants ont considéré que le cas était grave lorsqu’il s’agissait d’un homme contre 49% lorsque c’était une femme. De plus la douleur exprimée sur une échelle de 0 à 10 avait une moyenne de 5,4 pour les femmes contre 6 pour les hommes. Ainsi ceci procure de vraies conséquences pour les femmes car cela prouve la manière dont ces dernières sont prises en charge aux urgences leur créant une attente plus longue et une réception de médicaments plus longue.
De surcroît, les douleurs peuvent se retrouver aussi chez d’autres professionnels tels que le gynécologue. En effet, la société actuelle banalise la douleur féminine suite à des stéréotypes sociaux comme quoi les femmes sont souvent perçues plus résistantes à la douleur ce qui peut fausser l’interprétation de leurs symptômes. Par conséquent, quand une femme va chez le gynécologue, les consultations sont souvent millimétrées et les professionnels ne prennent pas de temps avec leur patiente pour les mettre à l’aise pour qu’elles puissent se sentir en confiance. Donc, le corps se crispe et se met en défense, ajouté à une vulnérabilité installée où la femme se met nue dans la position gynécologique n’aidant pas le corps à se détendre et rendant les choses douloureuses. Pour la petite histoire, la position gynécologique remonte à Louis XIV. Il faut savoir qu’à cette époque les femmes accouchaient dans des positions beaucoup moins vulnérables en étant assises, accroupies ou à quatre pattes. Frustré de ne pas voir en détails ce qu’il se passait, le roi instaure une nouvelle posture d’accouchement : la position gynécologique. Ainsi toutes ces mauvaises expériences peuvent traumatiser les femmes ne voulant plus retourner faire de consultations pouvant les mettre en danger. C’est pourquoi il est important de faire de la prévention sur leurs droits avec notamment la loi de Kouchner qui stipule « qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment », promulguée le 4 mars 2002.
Enfin, une autre chose sous-estimée par les professionnels de santé sont les risques d’AVC chez les femmes, longtemps considérés comme une maladie d’homme. Cependant l’AVC est la première cause de décès chez les femmes. Ces dernières sont sensibilisées au cancer du sein mais pas l’AVC. Il est possible de l’avoir à n’importe quel moment de sa vie et ¼ des femmes en ont un au cours de leur vie contre 1/5 pour les hommes. 80% des AVC peuvent être évités. Il existe différents facteurs de risque tel que l’hypertension artérielle, le surpoids, le tabac mais aussi la ménopause pour les femmes et enfin l’arythmie cardiaque plus fréquente chez les personnes âgées. Or, malgré toutes les difficultés rencontrées par les femmes, elles vivent plus longtemps que les hommes car selon L’INSEE une femme vit en moyenne 85,6 ans contre 80 ans pour un homme. Comme quoi la nature n’est pas si mal faite que ça!
Cloé G. et Julie W.